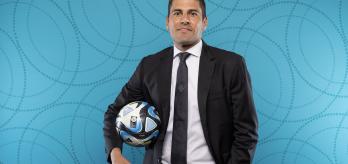La FIFA collabore avec des experts de renom comme Ric Lovell (professeur titulaire à l’université de Wollongong, sciences de l’exercice, Wollongong, Australie), Georgie Bruinvels (chercheuse associée à l’université de St Mary’s, Twickenham, Londres, Royaume-Uni) ou encore Scott. Cette orientation témoigne de sa volonté de faire progresser le football féminin grâce à des programmes d’entraînement et des projets de recherche sur mesure, à l’image du projet pour la santé des femmes et du Programme de préparation des équipes nationales féminines. Ces initiatives sont conçues pour soutenir la formation ainsi que la mise en œuvre de stratégies fondées sur des données factuelles pour soutenir le développement et la préparation des joueuses.
À partir de l’analyse des performances physiques recueillies pendant la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™, Scott propose une série de réflexions sur l’évolution des tendances observées lors des dernières éditions. Les seuils de vitesse, standardisés sur la base des recherches menées par Scott et ses collègues (Park et al., 2018), occupent une place importante dans ses travaux. Ces seuils servent à définir différents niveaux de vitesse de course durant un match de football. Scott souligne l'absence d'uniformité concernant les zones de vitesse utilisées dans le football féminin et la nécessité de mettre en place un cadre normalisé pour permettre des comparaisons pertinentes d’une étude ou d’un projet de recherche à l’autre. Elle note en outre que de nombreux facteurs influencent l’interprétation des données sur les performances physiques : systèmes de suivi, technologie utilisée, surfaces de jeu, conditions atmosphériques ou encore évolutions réglementaires.
Le présent article se veut une présentation de l’analyse de Dawn Scott, qui illustre la complexité de la question de la performance dans le football féminin et propose des stratégies pour l'accompagner vers de nouveaux sommets.
Collecte et analyse de données
-
Collecte de données Système à 3 caméras
-
Processus d’analyse : groupe consultatif
-
Compétitions comparées : 2007 et 2011 (durée des matches uniquement), 2015, 2019 et 2023
-
Total par équipe : toutes les joueuses de champ entrée sur le terrain, 90 minutes + temps additionnel uniquement
-
Comparaisons par poste : gardienne de but (GB), arrière latérale (AL), défenseure centrale (DC), milieu centrale (MC), milieu excentrée (ME), attaquante (AT), 90 minutes + temps additionnel uniquement
-
Étude de cas : AUS, ENG, ESP et SWE
-
Seuils de vitesse utilisés : voir illustration ci-dessous
-
Nous remercions en particulier les personnes suivantes pour leur contribution à cette analyse et à son interprétation : Dr Dean Norris, Richard Lovell, professeur titulaire, Belinda Wilson, Gemma Grainger, Dr Blanca Romero, Tom Gardner, Harry Lowe.
Comparaisons sur la durée du match
À partir de 2007, la durée des matches en Coupe du Monde Féminine a constamment augmenté. Il est toutefois intéressant de noter que le temps de jeu effectif reste, lui, relativement stable. La durée moyenne d’un match en 2015 s’établissait à 95’02. Elle est passée à 97’43 en 2019 pour atteindre 102’24 en 2023. L’introduction de la VAR a contribué de façon importante à cette évolution. Toutefois, le temps de jeu effectif en 2023 (56’54) est similaire a celui observé en 2011 (56’21) et en légère progression par rapport à l’édition 2019 (54’41).
Pour Scott, « si l’on considère l’augmentation de la durée des matches entre 2015 et 2023 (+7’22), on constate que celle-ci est principalement due à une augmentation des arrêts de jeu, comme en témoigne la stabilité du temps de jeu effectif sur cette période. Toutefois, si l’on doit préparer les joueuses à supporter un temps de jeu supérieur à 100 minutes, il convient de prendre en compte un certain nombre de facteurs physiques et psychologiques, a fortiori si la préparation en question concerne une compétition concentrée sur quelques semaines ».
Comparaison des zones de vitesse
L’une des évolutions les plus remarquables entre 2015 et 2019 concerne l’augmentation de la distance totale parcourue par les équipes et plus spécifiquement le volume de courses à haute intensité (SZ45). Toutefois, ces distances semblent avoir atteint un plateau en 2023, malgré l’augmentation de la durée des matches. Pour Scott, les tendances concernant la zone 3 (13-19 km) sont particulièrement pertinentes sur les trois dernières éditions. En effet, ce type de distances et les actions auxquelles elles correspondent sont trop souvent négligés dans la préparation physique des joueuses.
« La professionnalisation des équipes et des joueuses occupe, selon moi, un rôle important dans l’augmentation significative des distances parcourues en SZ45 observées entre 2015 et 2019. Il fallait s’attendre à ce que celles-ci atteignent un plafond, mais je note que les distances parcourues en SZ3 continuent d’augmenter. Il s’agit, le plus souvent, de courses de récupération, qui permettent aux joueuses de se replacer. Ces courses doivent être prises en compte dans les programmes d’entraînement hebdomadaire. En effet, le jeu est de plus en plus rapide, ce qui implique de se replacer plus vite. Le jeu reprend plus rapidement, ce qui explique pourquoi le volume de courses dans cette zone continue de croître. »
« Souvent, nous nous concentrons sur l’entraînement de haute intensité et les volumes de basse intensité. Il ne faut cependant pas négliger la zone intermédiaire (SZ3), surtout lorsque l’on constate que les distances parcourues à ce niveau d’intensité continuent d’augmenter de façon significative. Pour illustrer le type de courses réalisées dans cette zone de vitesse pendant un match, on peut penser à une joueuse allant se replacer après une montée à haute intensité. Ce type d'effort traduit en outre un plus grand sens des responsabilités sur le plan tactique. Cette tendance se retrouve chez toutes les équipes engagées dans la compétition et non uniquement chez les quatre demi-finalistes. On peut en conclure qu'il faut davantage se pencher sur ce seuil de vitesse. »
« De plus, on constate d’importantes disparités dans les distances parcourues par les différentes équipes. Ces écarts peuvent traduire des situations variables en termes de développement ou d’approche tactique. Lorsque l’on fait le total des distances parcourues par l’ensemble des joueuses de champ d'une même équipe sur un match, on observe des différences pouvant aller jusqu’à 30 km d'une rencontre à l'autre, ce qui est très important. Cela représente près de 3 km en moyenne par joueuse. De même, si l'on prend en compte la SZ45, l’écart s’établit à 5 km, soit 500 m par joueuse en moyenne. Enfin, si l’on détaille cette variance pour chaque poste, l’écart est de 4 km au total et 1,6 km en SZ45. »
ÉQUIPES CONCERNÉES PAR L’ÉTUDE DE CAS : Espagne, Angleterre, Suède, Australie
Avant de nous pencher sur l’étude de cas 2023, il convient de souligner l’augmentation importante de la distance totale parcourue par les équipes de la Coupe du Monde Féminine 2019 par rapport à l’édition 2015. Le tableau ci-dessous illustre le caractère significatif des distances parcourues par les joueuses en SZ45 (zones de vitesse 4 et 5 combinées). En 2023, on n’observe pas d’augmentation de la distance parcourue par l’Australie, l’Angleterre et la Suède à partir de ce seuil (l’Australie et l’Angleterre enregistrent même un léger recul). Toutefois, l’Espagne, lauréate de l’épreuve, affiche une hausse importante des distances parcourues aux plus hautes vitesses. Cette tendance s’explique en partie par le fait que son point de référence en 2015 était sensiblement plus bas que celui des trois autres équipes (cette date étant antérieure à la professionnalisation du championnat national et à l’augmentation du nombre de joueuses s’entraînant à plein temps). De plus, le classement final de l’Espagne sur ces trois éditions peut être associé à l’augmentation de ses performances physiques : phase de groupes en 2015, huitièmes de finale en 2019 et vainqueur en 2023.
Pour Scott, ces tendances sont complexes et doivent donc être interprétées avec prudence. « Il est nécessaire de mettre en perspective les efforts produits par les équipes pendant les matches. En effet, certaines baisses peuvent s’expliquer par des choix tactiques ou stratégiques. Elles peuvent aussi refléter l’évolution du score dans certaines rencontres ou le statut de l’équipe dans la compétition. Courir davantage n’est forcément synonyme de succès ; il faut aussi prendre en considération le type de courses et le contexte général. »
Comparaisons par poste
Au moment d’entamer la préparation des joueuses, il est nécessaire de prendre en compte les exigences spécifiques à leur rôle au sein de l’équipe, afin de mettre en place un programme d’entraînement adapté.
Selon Scott, « pour préparer les séances et définir la charge d’entraînement de chacune, il faut même réfléchir au rôle de chaque joueuse, à chaque poste. Par exemple, le rôle de faux 9 est très différent de celui d’un numéro 9 traditionnel. Pendant la Coupe du Monde Féminine, nous avons vu qu’une joueuse pouvait tenir différents rôles d’un match à l’autre, en fonction de l’adversaire et de la stratégie. »
« Ainsi, Georgia Stanway a évolué à différents postes avec l’Angleterre, tandis que Lauren Hemp a été alignée aussi bien en pointe que sur les côtés. Il est donc nécessaire de comprendre les exigences propres à chacun de ces postes et de ces rôles en termes d'intensité. La façon dont une équipe presse et les situations dans lesquelles elle déclenche son pressing, mais aussi le temps passé avec et sans le ballon, sont autant d’éléments qui peuvent influer sur les exigences en compétition. Pour analyser et comparer les performances physiques, il est donc indispensable de prendre en compte ces éléments et de les mettre en relation avec la stratégie et les rôles des joueuses. »
L’équipe médicale et les entraîneurs doivent aussi garder à l’esprit les considérations médicales individuelles (type de cycle, phase du cycle menstruel, fatigue, récupération...) lorsqu’ils établissent les programmes d’entraînement. Tous ces critères sont aussi importants que la connaissance et la compréhension des caractéristiques propres au football féminin.
PERFORMANCES PHYSIQUES ET PRESSING
Le contexte est essentiel pour comprendre les performances physiques des équipes pendant les phases de pressing. Au-delà du temps passé sans ballon, il est indispensable de comprendre comment, quand et pourquoi les équipes déclenchent leur pressing. Le temps passé dans les différentes phases défensives permet de mieux comprendre les approches et les capacités de chaque équipe.
Comme le montre le schéma 9, l’Espagne est l’équipe la moins encline à presser à partir d’un bloc bas. Ses performances physiques (distances parcourues en SZ45) augmentent lorsqu’elle passe à un bloc médian et sont au plus fort avec un bloc haut. Néanmoins, l’Espagne est aussi l’équipe qui a passé le moins de temps sans ballon dans toute la compétition. À l’inverse, la RP Chine a passé davantage de temps à presser avec un bloc bas ; beaucoup moins avec un bloc haut. Ces résultats illustrent les différentes approches en la matière.
Le schéma 10 montre quant à lui que les stratégies et les performances physiques ont évolué au fil de la compétition. L’Allemagne et l’Espagne sont les équipes ayant parcouru les plus faibles distances au pressing lors de la phase de groupes (sur 90 minutes).
ÉTUDE DE CAS
En se penchant sur les matches disputés par l’Angleterre et l’Espagne, les deux finalistes, ont comprend mieux le contexte général, ce qui permet d’éclairer plus nettement leurs parcours respectifs.
Les changements de formation, la stratégie de leurs adversaires, l’évolution de la compétition, la rotation des effectifs et la charge de travail cumulée ont eu des conséquences sur les performances physiques à chaque sortie. Si les moyennes font apparaître des tendances intéressantes, il est tout aussi nécessaire de se pencher sur les spécificités de chaque match.
Comme l’explique Scott, « le schéma ci-dessous montre que l’Angleterre a parcouru le plus de distance lors de son troisième match de groupe, une victoire 6-1 contre la Chine correspondant à un changement de formation. Lors du match .suivant contre le Nigeria, elle a réalisé son plus faible total dans cette catégorie. Les distances parcourues en SZ45 ont chuté après le premier match. Il a fallu attendre la demi-finale et la finale pour les voir remonter. Ceci peut être dû aux changements de formation et aux stratégies adoptées par les adversaires. Quand on regarde le nombre de pressings collectifs, ceux-ci fluctuent d’un match à l’autre. On observe toutefois une forte augmentation en finale contre l’Espagne, qui a dominé la possession de balle. Le schéma 7 montre quant à lui que l'intensité physique évolue d’un match à l’autre, en fonction des changements de poste, de temps de jeu et de rôle. Le cas de Lauren Hemp est un bon exemple : elle a parfois joué sur l’aile et parfois au poste d’avant-centre. Georgia Stanway a disputé quelques matches au poste de milieu défensif et d’autres en numéro 8. »
« Quand on retrace le parcours de l’Espagne, ont voit que ses meilleures performances en termes de distance totale parcourue et de distances parcourues en SZ45 ont été réalisées lors du deuxième match de groupe, contre la Zambie. Pour leur troisième sortie, une défaite 4-0 contre le Japon, les Espagnoles ont en revanche réalisé leur plus faible score (alors qu’elles étaient déjà qualifiées et qu’elles avaient parcouru des distances importantes en SZ45 lors des deux premiers matches). Il faut donc interpréter ces chiffres à la lumière du contexte : effort physique cumulé, rotation, plan de jeu, stratégie de l’adversaire, etc. Comme on peut le voir, après le match face au Japon, les distances parcourues en SZ45 augmentent régulièrement au fil de la compétition. » « De plus, l’Espagne a dominé la possession de balle dans ses matches. Les charges d'entraînement programmées pour les zones de vitesse avec et sans le ballon doivent donc varier d’une équipe à l’autre. »
TROISIÈME ET QUATRIÈME : Suède et Australie
En conservant la même méthode, il est possible de tirer des conclusions similaires à partir des performances physiques de la Suède et de l’Australie. Par exemple, si l’on observe le nombre de pressings collectifs déclenchés par la Suède lors de son entrée en lice face à l’Afrique du Sud (schéma 15), on constate que celui-ci se situe nettement en-dessous de sa moyenne sur les six autres matches. Ceci s’explique par le fait que les Suédoises ont dominé la possession. Elles ont réalisé leur deuxième score le plus faible contre l’Argentine, un match où, là aussi, elles ont pris l’ascendant en termes de possession.
« De même, si l’on s’intéresse au cas de l’Australie, on constate une progression régulière entre le premier et le deuxième match », explique Scott. « Les Australiennes ont ensuite livré leurs plus gros efforts face au Canada, à l’occasion d’une rencontre à quitte ou double pour la qualification. Une fois de plus, on constate que le contexte du match a son importance, mais il ne faut pas négliger pour autant les exigences propres à chaque poste et les capacités physiques des joueuses. Ainsi, le schéma 17 montre que Steph Catley (AUS) a disputé l’intégralité des minutes de son équipe, ce qui ne l’a pas empêchée de figurer régulièrement parmi les joueuses les plus mobiles. »
RÉSUMÉ
Le contexte est essentiel pour analyser les performances physiques et la charge d'entraînement, des équipes, mais aussi des joueuses. La durée du match, le temps de jeu effectif et le temps passé sur le terrain sont également des facteurs importants pour la périodisation de l’entraînement collectif. En compétition, les exigences qui pèsent sur chaque joueuse varient d'un match à l’autre en fonction de leur poste et des responsabilités propres à leur rôle, deux éléments qui s’inscrivent plus globalement dans une stratégie de jeu.
Au même titre que les capacités physiques des joueuses, la tactique, la disposition de l’adversaire, le style de jeu et l’évolution de la compétition sont aussi des questions à prendre en considération au moment de préparer ses séances d’entraînement et de récupération . Une fois tous ces éléments intégrés, la distance totale couverte par les équipes et les distances parcourues dans certaines zones de vitesse (collectivement et individuellement) peuvent faire l’objet d’une analyse contextualisée. Les technologies de suivi et d’analyse des données modernes sont des outils précieux car elles permettent aux entraîneurs d’observer précisément les performances physiques et d’ajuster la charge de travail en fonction des résultats. Il peut ainsi être nécessaire de réduire l’intensité ou de modifier certains exercices en fonction des données recueillies pour éviter la fatigue, réduire les risques de blessures ou optimiser la récupération.
La prise en compte d'éléments spécifiques à la santé des sportives, l’alimentation, les déplacements, le sommeil, la récupération, le bien-être psychologique et la fatigue influent sur l’état des joueuses d’un match à l’autre. Au fil des rencontres, ces évolutions peuvent avoir des conséquences. La question de la logistique (déplacements et hébergement) a aussi son importance, afin d’optimiser les périodes de repos et de préserver les cycles circadiens. Les stratégies en matière de nutrition doivent s’adapter pour correspondre aux dépenses énergétiques et aux besoins en matière de récupération. Les macronutriments (pour l’énergie) et des micronutriments (pour les défenses immunitaires) nécessitent une attention particulière.
Les équipes encadrantes pluridisciplinaires qui entourent les joueuses doivent posséder une grande expertise et communiquer entre elles, afin que les protagonistes puissent répondre aux exigences physiques propres à leur rôle et à la formation de l’équipe. Ce soutien est indispensable pour qu’elles puissent livrer les meilleures performances possibles. Lorsqu’une joueuse représente son pays, son club et son équipe nationale ont tout intérêt à coopérer pour veiller à son bien-être et à la satisfaction de ses besoins, ce qui assurera un niveau de performance optimal.
Les entraîneurs et les préparateurs physiques sont évidemment les premiers concernés, mais ils ne sont pas les seuls : les kinésithérapeutes, les nutritionnistes et les psychologues du sport ont également un rôle à jouer. Chaque professionnel contribue à cette approche globale de la santé de l’athlète, afin que les joueuses ne soient pas seulement prêtes physiquement, mais aussi solides mentalement.
Références
Park, Laurence & Scott, Dawn & Lovell, Ric. (2018). Velocity zone classification in elite women’s football: where do we draw the lines? Science and Medicine in Football. 3. 1-8. 10.1080/24733938.2018.1517947.
Présentation du projet de la FIFA pour la santé des femmes : https://inside.fifa.com/fr/womens-football/fifa-female-health-project-snapshot